Notes sur la révolution solidaire : partie I
Première partie : une nouvelle stratégie pour
la gauche québécoise du XXIe siècle
Stagnation électorale et lutte idéologique
Si la défaite historique du Parti québécois
et la crise du bloc souverainiste qui en découle laissent un espace vacant pour
une progression importante de la gauche, celle-ci sera-t-elle capable de tirer
parti de cette situation politique exceptionnelle et de rallier les forces
populaires à son projet de transformation sociale ? Rien n’est moins sûr.
Certes, Québec solidaire a obtenu une troisième députée à l’arraché (91 voix)
et augmenté son score électoral de 1,6%, marquant ainsi une croissance lente
mais constante. À cette vitesse, QS aura peut-être cinq député(e)s et 10% des
voix en 2018, puis une majorité parlementaire en… 2068. Bien que nous ne
pouvions extrapoler de tels résultats sur la longue durée, la gauche québécoise
ne peut se contenter de la lente montée qui caractérise sa trajectoire depuis
bientôt une dizaine d’années. Quelques mouvements sociaux inquiets, des
centrales syndicales peu combatives et trois député(e)s solidaires à
l’Assemblée nationale ne permettront pas d’apporter les transformations
majeures dont notre société a besoin pour assurer l’avenir de son territoire,
ses institutions et les générations futures.
Comment expliquer une telle stagnation
électorale, malgré la désorientation du Parti québécois, l’agonie d’Option
nationale, l’instabilité de la Coalition Avenir Québec et la corruption avérée
du Parti libéral ? Un budget sans précédent, un autobus de campagne, un
cadre financier, un matériel visuel élégant, une présence des porte-paroles
dans toutes les régions et un bon travail de terrain sont des ingrédients
importants, mais insuffisants. Le rapport de forces sur la scène politique, l’espace
public et la société en général est largement en défaveur de la gauche, et
celle-ci ne réussira pas à convaincre une majorité avec l’image d’un cœur évoquant
la « gauche calinours ». Il ne s’agit pas ici de critiquer le travail
acharné de la direction et de la base militante durant la dernière campagne,
mais de tirer un bilan réaliste permettant d’orienter l’action politique du
parti et d’apporter les changements majeurs qu’il devra apporter pour être à la
hauteur de la tâche historique qui l’attend.
 C’est pourquoi il est nécessaire de tracer
les contours d’une nouvelle stratégie pour la gauche dans le contexte
sociohistorique des années 2010. Même une campagne électorale avec un slogan
sympathique, une bonne plateforme de propositions et des lignes de communication efficaces
ne pourra défaire les nombreux préjugés à l’endroit du projet solidaire. La
gauche politique doit briser le plafond de verre, élaborer un nouveau discours
qui prend à rebrousse-poil l’idéologie néolibérale, et préparer une offensive
en vue de la prise du pouvoir. Cela est d’autant plus urgent que les idées
progressistes ne parviennent pas à frapper l’imaginaire des classes moyennes et
populaires, toujours séduites par le chant des sirènes de la droite qui les
soudent aux classes dominantes. Prendre au sérieux le rôle central de la lutte
idéologique dans le combat politique doit nous mener à une interrogation
fondamentale, non sur la nature de nos principes (justice sociale,
indépendance, écologie, etc.), mais sur leur formulation appropriée au niveau
de conscience des masses. Cela implique non pas de mouler les concepts de la
gauche au cadre de l’idéologie dominante, mais de retraduire, dans les termes
d’une pensée de l’émancipation, les craintes et les aspirations réelles de la
majorité sociale qui se trouvent actuellement canalisées par le discours
conservateur.
C’est pourquoi il est nécessaire de tracer
les contours d’une nouvelle stratégie pour la gauche dans le contexte
sociohistorique des années 2010. Même une campagne électorale avec un slogan
sympathique, une bonne plateforme de propositions et des lignes de communication efficaces
ne pourra défaire les nombreux préjugés à l’endroit du projet solidaire. La
gauche politique doit briser le plafond de verre, élaborer un nouveau discours
qui prend à rebrousse-poil l’idéologie néolibérale, et préparer une offensive
en vue de la prise du pouvoir. Cela est d’autant plus urgent que les idées
progressistes ne parviennent pas à frapper l’imaginaire des classes moyennes et
populaires, toujours séduites par le chant des sirènes de la droite qui les
soudent aux classes dominantes. Prendre au sérieux le rôle central de la lutte
idéologique dans le combat politique doit nous mener à une interrogation
fondamentale, non sur la nature de nos principes (justice sociale,
indépendance, écologie, etc.), mais sur leur formulation appropriée au niveau
de conscience des masses. Cela implique non pas de mouler les concepts de la
gauche au cadre de l’idéologie dominante, mais de retraduire, dans les termes
d’une pensée de l’émancipation, les craintes et les aspirations réelles de la
majorité sociale qui se trouvent actuellement canalisées par le discours
conservateur.
Du parti mouvement à la
métamorphose
Dans une réflexion intéressante sur les
perspectives d’organisation pour Québec solidaire, Benoit Renaud appelle
l’émergence d’un « parti mouvement », c’est-à-dire d’une
formation politique axée sur la mobilisation permanente et l’ancrage dans les
luttes sociales. Il suggère de compléter les campagnes politiques nationales
(Courage politique, Pays de projet, Sortir du noir) qui ratissent large mais avec
« des grands filets plein de trous », par de petites campagnes
ciblées et des actions locales qui permettent de ratisser serré :
signatures de pétitions, réunions publiques, assemblées de cuisine, rencontres
de mobilisation, etc. « Aussi,
les campagnes, grandes et petites, longues et courtes, devraient occuper
l’essentiel du temps que nos membres seront disposé à consacrer au parti. Il
s’agit de donner une importance secondaire à nos affaires internes pour se
tourner vers l’extérieur en direction de la base électorale du parti et de la
population. »[1]
Cette perspective extravertie s’accompagne
d’une construction de l’opposition dans la société civile par le développement
du « parti de la rue », c’est-à-dire le renforcement et
l’articulation des mouvements sociaux. Avec le règne du PLQ qui continuera de
miser sur l’austérité (coupures budgétaires, hausse des tarifs et privatisation
des services publics), le bradage des ressources naturelles (Plan Nord, projets
de pipelines) et le pouvoir patronal, l’essentiel de la résistance devra
prendre la forme de contre-pouvoirs, comités citoyens, assemblées démocratiques
et mobilisations populaires cherchant à contester l’ordre établi. Grâce au
récent déclin de l’emprise du PQ sur le milieu communautaire et syndical (notamment
avec le recrutement de PKP qui risque de devenir le futur chef du parti), la
convergence et la complémentarité entre la lutte politique et les mouvements
sociaux pourrait amener une avancée importante de QS aux prochaines élections.
« C’est la possibilité de ce saut qualitatif qui a donné à
plusieurs le sentiment que le résultat du 7 avril était une réelle progression,
une raison indéniable de se réjouir. Mais si nous échouons à réaliser ce
potentiel, un résultat presque identique dans quatre ans aurait un effet pour
le moins démobilisant. Bref, on peut voir l’élection d’avril 2014 comme une
marche de plus dans une longue escalade, ou on peut la voir comme un
tremplin. »
Or, Benoit Renaud remplace la perspective des petites avancées
dans les urnes (aile parlementaire) par celle des « petits pas » dans
la rue (aile extra-parlementaire), envisageant le changement qualitatif comme une extension quantitative des activités militantes.
Il ne s’agit pas de modifier le contenu de la lutte idéologique, mais de
déplacer le terrain sur laquelle elle se déroule. Cette stratégie souhaite
construire un « nouveau sens commun » en réfutant le discours
dominant avec les mêmes arguments, mais en complétant la propagande par le haut
(sphère médiatique) par la propagande par le bas (espaces publics concrets, rencontres
en face à face).
« À
chaque pas, à chaque porte, sur chaque rue, dans chaque manifestation, sur
chaque piquet de grève, avec chaque signature ajoutée sur une pétition, chaque
nouveau membre, chaque petit don, chaque débat d’idée, chaque petite victoire,
nous ferons la démonstration par la pratique qu’un autre Québec est possible,
un Québec libre, juste, vert et solidaire. »
Bien qu’il soit absolument nécessaire de
renforcer le parti de la rue pour contrebalancer le poids croissant de l’aile
parlementaire (qui représente tout de même une bonne nouvelle), que ce soit par
la mobilisation interne, les campagnes locales, le contact humain et le
rapprochement avec les mouvements sociaux, Québec solidaire a besoin d'un réel
renouvellement dans son discours, son image, et même sa stratégie. Autrement
dit, il ne faut pas seulement accélérer le pas dans la même direction, mais
faire un virage qui nous permettra de gagner en force dans plusieurs couches de
la population. Le parti ne doit pas simplement intensifier son discours et
marteler le même message (crier plus fort pour que personne ne nous ignore),
mais parler autrement en opérant une métamorphose. Le changement doit être
qualitatif, tant sur le plan des représentations collectives qu'au niveau de
l'action politique.
Il ne s'agit pas de réviser notre programme de fond en comble,
car les nombreuses propositions déjà adoptées canalisent amplement les revendications
des luttes sociales et les intérêts de la majorité de la population. Nous devons
mener une lutte idéologique sans précédent, c'est-à-dire élaborer un « nouveau
sens commun » qui ne se limite pas à nier les idées de la droite et
affirmer que notre projet est réaliste et qu'un autre monde est possible ; il
faut définir positivement et concrètement notre vision du monde en fonction des
aspirations populaires, c'est-à-dire en s'adaptant au niveau de conscience
général tout en amenant celui-ci vers notre projet de société. La question
n’est pas de privilégier l’aile parlementaire ou extra-parlementaire, mais de
structurer autrement les idées directrices du parti et d’agir sur tous les
fronts, afin de rendre le projet
solidaire sensible au peuple québécois.
Cette affirmation doit être comprise dans les deux sens. D’une
part, la vision de la gauche doit être largement partagée, et par le fait même
devenir intuitive pour la majorité. Une mutation culturelle est nécessaire pour
qu’un nombre suffisant de citoyens et citoyennes croient à nouveau en leurs
capacités et soient prêts à vouloir un important changement politique et
économique. La formation d’une volonté collective est donc le prérequis d’une
réelle transformation sociale. D’autre part, la construction d’un sujet politique suppose que Québec
solidaire devienne lui-même sensible aux craintes et espoirs populaires, afin
d’apporter une réponse positive capable d’unifier le peuple dans la direction de
l’émancipation sociale.
Or, cette idée a du plomb dans l’aile, tout comme sinon plus que
le rêve abîmé de la souveraineté. Dans un contexte idéologique grisâtre, dominé
par le conservatisme, le cynisme et la morosité, il n’est plus possible de
brandir comme telle les idées de justice sociale ou d’indépendance nationale,
du moins dans le même cadre où elles ont été élaborées et diffusées dans les
dernières décennies. Ces principes n’évoquent plus, pour la plupart, les
passions populaires qui les ont jadis portées par des mouvements qui voulaient
changer la société. L’habitude d’énumérer les sept principes de Québec solidaire
(égalité, féminisme, écologie, souveraineté, démocratie, altermondialisme,
pluralisme) n’amène qu’une succession mécanique d’abstractions pour la
majorité, même si ces idéaux ont une valeur certaine et possèdent une
signification pour les membres du parti et les personnes qui partagent une
certaine culture politique de gauche. Le discours solidaire ressemble trop
souvent à l’évocation d’idées qui n’ont d’évidence que pour une minorité, alors
que des valeurs communes doivent nécessairement être attachées à des affects
déposés par la sédimentation de l’histoire.
Repenser
le mouvement historique
La signification du « parti mouvement » ne doit pas
être réduite à la culture militante des mouvements sociaux, mais être élargie à
celle de larges transformations historiques. Autrement dit, la gauche ne doit
pas d’abord s’adresser aux progressistes contemporains, mais rappeler les
contenus du passé collectif pour aimanter l’inconscient social vers l’avenir
d’une promesse inaccomplie. La stratégie discursive consiste à réactiver le
souvenir du dernier grand mouvement de l’histoire du Québec : la
Révolution tranquille. Il s’agit de dé-diaboliser le mot
« révolution » en l’associant à cette importante transformation
sociale, politique, économique et culturelle qui a forgé l’identité québécoise
contemporaine. Cet exemple historique permet de montrer que la révolution n’est
pas un idéal inaccessible, mais une utopie qui a déjà eu lieu dans notre propre
passé. Si l’idée d’une libération sociale et nationale est un rêve, celui-ci
habite notre mémoire comme une image qui vise le présent dans l’attente d’un
avenir qui accomplirait l’espoir des générations précédentes. « Chaque
époque rêve la suivante », disait Michelet. Dans sa deuxième thèse sur le
concept d’histoire, Walter Benjamin reprend cette idée en concevant le salut
collectif par l’écoute attentive des échos du passé.
« Le passé est marqué d’un indice secret,
qui le renvoie à la rédemption. Ne sentons-nous pas nous-mêmes un faible
souffle de l’air dans lequel vivaient les hommes d’hier ? Les voix
auxquelles nous prêtons l’oreille n’apportent-elles pas un écho de voix
désormais éteintes ? Les femmes que nous courtisons n’ont-elles pas des
sœurs qu’elles non plus connues ? S’il en est ainsi, alors il existe un
rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. Nous avons été
attendus sur la terre. À nous, comme à chaque génération précédente, fut
accordée une faible force messianique
sur laquelle le passé fait valoir une prétention. Cette prétention, il est
juste de ne point la repousser. L’historien matérialiste en a
conscience. »[2]
Repenser la révolution québécoise dans le
contexte du XXIe siècle nous oblige à regarder en arrière pour mieux
nous catapulter vers l’avant, le projet de pays n’étant pas autre chose que
l’actualisation des revendications du passé. La gauche doit reprendre à son
compte la tâche historique que la bourgeoisie n’a pas su réaliser, à savoir
l’accomplissement de ce grand projet social et national inachevé. En effet, si
le Parti libéral du Québec édifia la charpente de l’État-providence pour
laisser place au Parti québécois qui poursuit la construction des institutions
publiques dans le sens d’une affirmation nationale devant aboutir à la
souveraineté, ce processus fut brusquement interrompu par l’échec du référendum
de 1980 et la dépression économique qui mit un terme au règne des Trente
Glorieuses et à l’espoir d’une émancipation collective imminente.
Ce tournant marqua l’effondrement de la gauche
politique et l’abattement du projet souverainiste, qui reprit seulement du poil de
la bête durant le bref sursaut référendaire de 1995 qui résultat sur une
seconde défaite. Il s’en suit un aplatissement collectif permettant la
consolidation du néolibéralisme et de l’autonomisme sous les figures de Lucien
Bouchard, Mario Dumont, Jean Charest et Pauline Marois. Le renoncement au
projet de société et à la souveraineté ne pouvait pas ne pas conduire à une
crise de l’identité québécoise, celle-ci étant moins définie par une culture
stable de survivance (telle qu’imaginée par les nationalistes conservateurs qui
veulent réanimer le rêve canadien-français), que par un effort vers
l’actualisation de soi, un processus fragile qui doit toujours être renouvelé. Il ne s’agit
pas d’opposer l’appartenance à une culture particulière au nationalisme civique
fondé sur des valeurs universelles, mais de comprendre la culture comme un élan
précaire vers des institutions qui n’existent pas encore.
Seule la grève étudiante de 2012 permit de
sortir le peuple québécois de sa torpeur, amenant une effervescence collective
qui n’avait jamais été aussi forte depuis l’épisode de 1995 et les années 1970.
Or, cette « crise sociale », qui représente en fait une résurgence inespérée,
fut rapidement colmatée par le retour du Parti québécois, dont le rôle
historique fut davantage de refermer la brèche du printemps érable que d’ouvrir
un nouvel espace de liberté politique. La fenêtre qui laissa apparaître la
lueur d’une autre société qui hésitait à naître dans les ruines du vieux monde
fit place à l’ombre du nationalisme identitaire et le retour du gouvernement
libéral qui permit d’apaiser la crainte d’un avenir menaçant.
Les dangers du progrès
Tout combat politique repose sur des
conceptions divergentes de l’histoire, qui demeure le principal terreau des
illusions, de droite comme de gauche. Le récent débat sur la Charte des valeurs
québécoises opposa principalement deux camps, les conservateurs visant
l’affirmation nationale par la reconstruction d’une identité unitaire, et les
progressistes défendant la réconciliation de la diversité sous le signe de
l’ouverture et du progrès. Si nous pouvons facilement montrer les
contradictions et les limites d’une approche qui renforce l’antagonisme entre
une majorité définie par des valeurs abstraites (égalité hommes-femmes,
laïcité, encadrement légal des accommodements raisonnables) et des minorités
culturelles, la gauche inclusive, qu’elle soit fédéraliste ou souverainiste,
semble avoir négligé l’exigence du passé et la nécessité de construire un monde
commun par-delà l’idée d’une évolution triomphante vers l’égalité et la justice
sociale.
Le problème réside moins dans l’idéal de
solidarité que dans la croyance implicite en la nécessité historique du progrès
moral. Tel est le piège d’une gauche qui croit que son discours s’achemine graduellement
vers la victoire ; elle troque l’idée de Révolution pour celle de la
tranquillité, de l’amour du prochain qui se révèle par un vote rationnel
accompagné des bons sentiments du cœur. Benjamin considère que ce leurre est inhérent
à la social-démocratie, dont la philosophie peut être résumée par cette phrase
limpide de Josef Dietzgen : « tous les jours notre cause devient plus
claire et le peuple tous les jours plus intelligent ».
« Dans sa théorie, et plus encore dans sa
pratique, la social-démocratie a été guidée par une conception du progrès qui
ne s’attachait pas au réel, mais émettait une prétention dogmatique. Le
progrès, tel qu’il se peignait dans la cervelle des sociaux-démocrates, était
premièrement un progrès de l’humanité elle-même (non simplement de ses
aptitudes et de ses connaissances). Il était deuxièmement un progrès illimité
(correspondant au caractère indéfiniment perfectible de l’humanité). Il était
envisagé, troisièmement, comme essentiellement irrésistible (se poursuivant
automatiquement selon une ligne droite ou une spirale). Chacun de ces prédicats
est contestable, chacun offre prise à la critique. Mais celle-ci, si elle se
veut vigoureuse, doit remonter au-delà de tous ces prédicats et s’orienter vers
quelque chose qui leur est commun. L’idée d’un progrès de l’espèce humaine à
travers l’histoire est inséparable de celle d’un mouvement dans un temps
homogène et vide. La critique de cette dernière idée doit servir de fondement à
la critique de l’idée de progrès en général. »[3]
Repenser la stratégie pour la gauche
québécoise suppose donc de rompre avec ce mythe du progrès continu, sans pour
autant renoncer aux espoirs des générations passées. Un discours inspirant ne
doit pas simplement se présenter comme une alternative au néolibéralisme, ni
même comme un parti apte à gouverner par des politiques publiques responsables
et capables d’équilibrer l’économie et la justice sociale. La négation de
l’ordre existant ou la bonne gestion du présent ne sont pas des idées
mobilisatrices. La gauche doit répondre à la crise identitaire qui naît de la
tension non résolue d’un modèle social en désuétude, hérité d’une époque où les
rêves étaient encore vivants. Ainsi, elle pourrait créer une tendance (au sens
d’une mode, d’un ensemble de comportements ou de mœurs se propageant par
imitation) par une reprise d'un appel du passé sous une nouvelle forme.
« L’histoire est l’objet d’une
construction dont le lieu n’est pas le temps homogène et vide, mais le temps
saturé d’« à-présent ». Ainsi, pour Robespierre, la Rome antique
était un passé chargé d’« à-présent », qu’il arrachait au continuum
de l’histoire. La Révolution française se comprenait comme une seconde Rome.
Elle citait l’ancienne Rome exactement comme la mode cite un costume
d’autrefois. La mode sait flairer l’actuel, si profondément qu’il se niche dans
les fourrés de l’autrefois. Elle est le saut du tigre dans le passé. Mais ceci
a lieu dans une arène où commande la classe dominante. Le même saut, effectué sous
le ciel libre de l’histoire, est le saut dialectique, la révolution telle que
la concevait Marx. »[4]
Accomplir
la Révolution tranquille
Que signifie ce « saut dialectique »
qui permet de dénicher la révolution par le retour de l’histoire ? En
fait, la révolution dont il est question relève moins de la prolongation que
d’une réappropriation critique du passé ; elle ne se trouve pas dans la
continuité mais dans une interruption capable de « faire éclater le
continuum de l’histoire. » C’est pourquoi l’héritage de la Révolution
tranquille ne doit pas se réduire à la défense du déjà-là, à un prolongement
linéaire de l’État-providence bienveillant et d’une souveraineté à portée de la
main. La reprise historique doit être l’occasion d’un profond renouvellement,
tant du projet de société que de la lutte de libération nationale, à l’aune des
défis du nouveau siècle.
La confiance envers le progrès si puissante dans les années 1960 et 1970 n’est plus tenable à l’époque de la crise
financière, énergétique, démocratique et écologique. L’utopie social-démocrate
supposait des ressources naturelles abondantes, une croissance économique
soutenue et un large consensus social qui n’existe plus aujourd’hui. Le soleil radieux du progrès laisse place à la conscience d’un orage imminent, sans pour autant céder au désenchantement qui ramène trop souvent au
conformisme et au traditionalisme. Le conservatisme québécois, de même que le
nationalisme identitaire visant à l’aiguiser dans le sens du projet national,
viennent de ce renoncement à l’idée de progrès faisant suite à la désillusion
du peuple face au rêve perdu de la Révolution tranquille. La seule voie de
sortie consiste non pas à défendre comme tel cet héritage en crise à l’époque
actuelle, mais à renouer un rapport non-traditionnel à notre propre tradition.
Cet « enracinement critique » permet de dégager une signification
inattendue à la devise « je me souviens », tout en lui donnant une
charge révolutionnaire.
« Faire œuvre d’historien ne signifie pas
savoir « comment les choses se sont réellement passées ». Cela
signifie s’emparer d’un souvenir, tel qu’il surgit à l’instant du danger. Il
s’agit pour le matérialisme historique de retenir l’image du passé qui s’offre
inopinément au sujet historique à l’instant du danger. Ce danger menace aussi
bien les contenus de la tradition que ses destinataires. Il est le même pour
les uns et pour les autres, et consiste pour eux à se faire l’instrument de la
classe dominante. À chaque époque, il faut chercher à arracher de nouveau la
tradition au conformisme qui est sur le point de la subjuguer. Car le messie ne
vient pas seulement comme rédempteur ; il vient comme vainqueur de
l’antéchrist. Le don d’attiser dans le passé l’étincelle de l’espérance
n’appartient qu’à l’historiographe intimement persuadé que, si l’ennemi
triomphe, même les morts ne seront pas en sûreté. Et cet ennemi n’a pas fini de
triompher. »[5]
 Plus concrètement, la gauche doit cesser de se
concevoir comme la gardienne des vertus d’un modèle québécois qui ne fonctionne
plus, et arrêter de vouloir trouver le juste chemin d’un consensus où il n’y
aurait plus d’adversité. Elle ne doit plus avoir peur que son projet radical heurte le bon sens populaire, en se donnant une image candide qui masque mal sa
volonté de transformer la société. Elle doit passer d’un discours moral, basé
sur des valeurs et la gentillesse, à une posture politique qui assume sa
mission historique, sans pour autant brandir le poing levé et adopter un
discours militant aux accents démodés. Autrement dit, il nous faut une gauche décomplexée mais nuancée. Cette transformation de l’image de soi
est un prérequis pour que la gauche puisse un jour accélérer une prise de
conscience généralisée. Mais comment surmonter l’opposition entre la
social-démocratie calinours et le cliché d'une gauche anticapitaliste ? Comment renouveler le
discours révolutionnaire alors que les idées de centre-gauche sont elles-mêmes
de moins en moins populaires ? Comment ratisser plus large sans se
recentrer, évoquer la révolution sans se marginaliser ?
Plus concrètement, la gauche doit cesser de se
concevoir comme la gardienne des vertus d’un modèle québécois qui ne fonctionne
plus, et arrêter de vouloir trouver le juste chemin d’un consensus où il n’y
aurait plus d’adversité. Elle ne doit plus avoir peur que son projet radical heurte le bon sens populaire, en se donnant une image candide qui masque mal sa
volonté de transformer la société. Elle doit passer d’un discours moral, basé
sur des valeurs et la gentillesse, à une posture politique qui assume sa
mission historique, sans pour autant brandir le poing levé et adopter un
discours militant aux accents démodés. Autrement dit, il nous faut une gauche décomplexée mais nuancée. Cette transformation de l’image de soi
est un prérequis pour que la gauche puisse un jour accélérer une prise de
conscience généralisée. Mais comment surmonter l’opposition entre la
social-démocratie calinours et le cliché d'une gauche anticapitaliste ? Comment renouveler le
discours révolutionnaire alors que les idées de centre-gauche sont elles-mêmes
de moins en moins populaires ? Comment ratisser plus large sans se
recentrer, évoquer la révolution sans se marginaliser ?
Le nœud du problème réside dans la critique du modèle québécois
que la gauche doit assumer afin que la droite ne monopolise plus ce discours.
Il s’agit en quelque sorte de renoncer à la défense simpliste de ce bloc
historique sans abandonner ses potentialités, et de déconstruire le mythe du
progrès continu dans un temps homogène et vide sur lequel il était basé. Il
faut passer d’une prolongation de l’existant à une véritable réactualisation
d’un projet interrompu, par un mouvement dialectique procédant par une
reprise/dépassement, réalisation/renversement. Autrement
dit, l’accomplissement de la Révolution tranquille implique la transformation
du modèle québécois et de l’identité collective qui lui est attachée. Alors
que les vieux partis évitent de remettre directement en question cette Idée en
parlant d’économie et de bon gouvernement, ou souhaitent carrément sa mort par
le démantèlement de l’État-providence, la gauche ne peut pas simplement défendre le statu quo par la préservation d'un modèle institutionnel en crise
structurelle. Elle doit prendre le taureau par les cornes en provoquant la Renaissance
de la Révolution tranquille dans l’imaginaire collectif.
Pour ce faire, il faut réactiver les potentialités du mot
« révolution » enfouies dans le passé pour la faire briller dans le crépuscule de notre civilisation. « L’image vraie du
passé passe en un éclair. On ne peut
retenir le passé que dans une image qui surgit et s’évanouit à l’instant même
où elle s’offre à la connaissance. »[6] Et une véritable
révolution suppose davantage qu’une consolidation des institutions publiques qui
s’usent à force de subir la pression des classes dominantes et l’indifférence d’une
majorité refermée sur la sphère privée. Le Québec a besoin d’un orage capable d’éveiller le besoin d’une réappropriation de son identité par le
pouvoir instituant qui pourra lui donner forme. En d’autres termes, la gauche
doit s’affairer à poser le problème susceptible de provoquer une mobilisation
en faveur d’un changement sans précédent : la transformation de l’État
québécois.
À suivre.
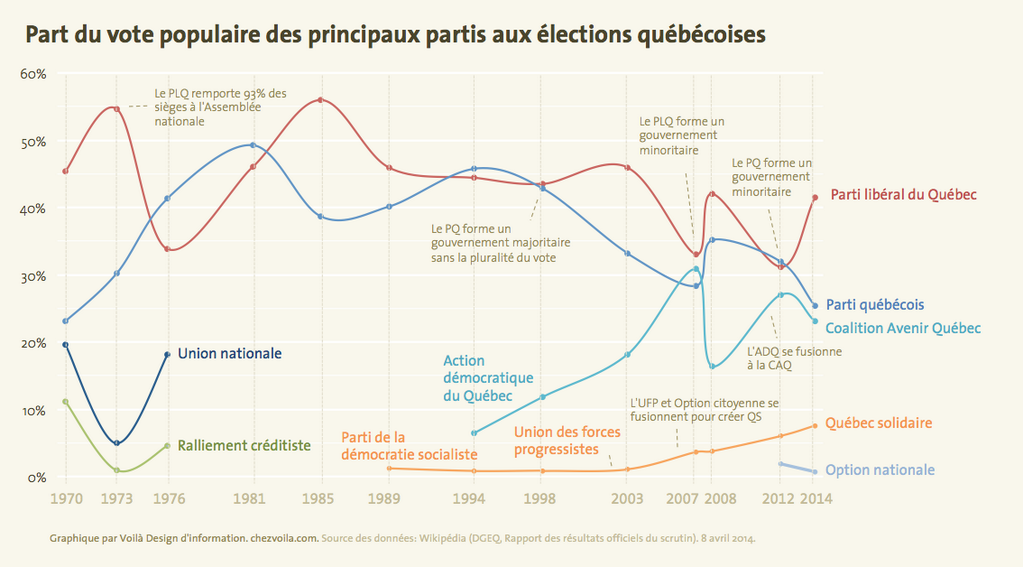











«Être québécois c'était dépasser le canadien-français. Ce dépassement n'est pas terminé. Le vieux fossile est toujours là» -Gordon Lefebvre
RépondreSupprimerMerci pour vos réflexions plus que nécessaires à cette heure des bilans.
RépondreSupprimerCe commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimerEn quoi le nationalisme identitaire est-il une forme de conservatisme ou de frein au progressisme social, je vous prie? L'idée d'identité nationale et d'affirmation nationale serait-elle dépassée ou trop fascisante pour les mouvements de gauche? Je crois qu'au contraire, il faut d'abord s'atteler à définir le Québec de manière claire et concertée avant de lui suggérer le choix radical d'une économie socialiste (projet très louable, soit dit en passant). Une telle évolution, si jamais elle vient à terme, rencontrera autant sinon plus de résistance que l'appel à l'affirmation identitaire. Mais cette dernière, j'en suis convaincu, sera le premier jalon vers un Québec solidaire, car on ne verra enfin en la société québécoise un peuple confiant en ses moyens et son devenir que lorsqu'il se sera pleinement assumé comme tel.
RépondreSupprimerParlant de mots au potentiel révolutionnaire qu'il conviendrait d'aller extirper de la tradition, que pensez-vous de la démocratie? Cette démocratie que personne n'ose renier explicitement, mais que les citoyens n'osent généralement pas considérer comme un projet inachevé. Je ne parle pas des réformes du parlementarisme (scrutin, etc.), je ne parle même pas des démocraties participatives ou directes possibles à l'échelle locale, municipale ou régionale. Je parle d'une démocratie du travail, l'autogestion du travail, qui serait, si elle était appliquée sérieusement, potentiellement anti-capitaliste et révolutionnaire, mais tout en faisant appel à quelque chose de connu par la plupart des gens, que peu de gens oseraient contester du moins dans sa forme actuelle.
RépondreSupprimerJe perçois une contradiction immense dans notre culture entre une acceptation de l'idée de démocratie, et une acceptation que cette idée s'arrête là ou la vie quotidienne, le travail, commence. Quand je parle à mes ami(e)s ou ma famille de Marx, j'évoque explicitement une étiquette entachée de décennies de propagande anti-marxiste, je cours le risque (pas toujours réel, mais quand même...) d'être associé à tort à Staline ou à la Corée du Nord ou aux extra-terrestres. Mais si je parle de démocratie... c'est plus tolérable, généralement. Quand j'en arrive à la démocratie du travail, à l'autogestion, etc. je commence à percevoir réticence, scepticisme et même colère, mais au moins c'est par le biais du concept de démocratie qui est accepté et même considéré ironiquement par la plupart des gens comme le (seul?) garant que nous vivrions (supposément) dans une société belle et libre, et que donc nous pouvons vaquer à notre train train quotidien sans se soucier de politique.