Pour en finir avec le mythe de la tarification progressive
L’argument de Jocelyn Maclure
Selon le professeur de philosophie Jocelyn Maclure, je serais un de ces « progressistes qui se réveillent la nuit
pour haïr la tarification » [1]. Pour reprendre une expression philosophique difficilement traduisible
en français : « I bite the bullet ». Autrement dit, j’accepte de
tirer les conséquences ultimes de certaines croyances à l’origine de cette
hostilité envers la tarification des services publics, tout en donnant une
justification normative capable de répondre aux arguments de mon adversaire.
Celui-ci critique le « fétichisme de l'impôt progressif » et justifie la tarification progressive des services de garde en y voyant un signe d'équité, avalisant ainsi le principe général sous lequel s’opère actuellement la réforme du modèle québécois par le gouvernement libéral. Peu importe les modalités qui affectent cette mesure particulière, il s’agit ici de critiquer l’idée générale selon laquelle il serait raisonnable « d’augmenter modérément les impôts des membres du 10%, du 5% et du 1% les plus riches, et d’augmenter modérément les tarifs de certains services collectifs ». L’argument principal attribue le fardeau de la preuve à ceux qui refusent la tarification progressive (le principe de la « juste part » ou de l’utilisateur-payeur) en faveur d’un système fiscal principalement basé sur l’imposition progressive sur le revenu.
Celui-ci critique le « fétichisme de l'impôt progressif » et justifie la tarification progressive des services de garde en y voyant un signe d'équité, avalisant ainsi le principe général sous lequel s’opère actuellement la réforme du modèle québécois par le gouvernement libéral. Peu importe les modalités qui affectent cette mesure particulière, il s’agit ici de critiquer l’idée générale selon laquelle il serait raisonnable « d’augmenter modérément les impôts des membres du 10%, du 5% et du 1% les plus riches, et d’augmenter modérément les tarifs de certains services collectifs ». L’argument principal attribue le fardeau de la preuve à ceux qui refusent la tarification progressive (le principe de la « juste part » ou de l’utilisateur-payeur) en faveur d’un système fiscal principalement basé sur l’imposition progressive sur le revenu.
« Je n’ai toutefois pas encore trouvé
l’explication et la justification de la proposition voulant que seule
l’imposition progressive puisse favoriser l’égalité et la solidarité. La
tarification progressive, après tout, fait payer les plus riches pour des
services qu’ils désirent obtenir. S’il s’agit, par exemple, d’augmenter
modérément le prix des places dans les CPE, les droits de scolarité ou les
tarifs d’hydroélectricité pour les plus fortunés, nous demeurons loin d’une
application intégrale du principe régressif de l’
« utilisateur-payeur ». Il s’agit plutôt de faire payer un peu plus
le bénéficiaire d’un service public qui en a les moyens. […] Il faut éviter,
lorsqu’il est question des politiques fiscales et de justice distributive, le
sophisme du faux dilemme. Ce n’est pas parce que l’on pense que la tarification
progressive doit être envisagée que l’on ne peut pas soutenir l’impôt
progressif, la taxation du capital ou la lutte contre l’évasion fiscale. Il
s’agit de se rapprocher de l’assortiment de mesures fiscales qui concilient le
mieux équité, solidarité et efficience. » [2]
Pour renverser cette argumentation, il s’agit de montrer en quoi
l’application de la tarification progressive nuit directement à l’équité, la
solidarité et l’efficience, et que seul un système fiscal véritablement
égalitaire permettrait d’assurer le financement de biens publics comme les services de garde, au contraire d’une « juste part »
des parents fortunés. Tout d’abord, il est
remarquable que l’argument invoqué pour justifier la réforme Couillard en
matière des CPE soit le même qui fut utilisé par le gouvernement Charest qui affirmait que les étudiants allaient bénéficier davantage de leurs études
universitaires que le reste des contribuables, et qu’ils devaient donc payer
davantage pour leurs droits de scolarité. On rejette ainsi l’universalité et la
(quasi-)gratuité des services publics en affirmant que les personnes sans
enfants (et les entreprises) ne devraient pas contribuer au financement des CPE,
car ils n’en bénéficient pas « autant » que les familles directement
concernées.
« Lorsque l’on défend la position
qu’il est préférable d’ajouter des paliers d’imposition plutôt que de moduler les tarifs en fonction
des revenus, on dit que ceux qui, par exemple, n’ont pas d’enfants doivent
financer à la même hauteur les services de garde que les parents qui en
bénéficient. Je suis parfaitement d’accord avec l’idée que ceux qui n’ont pas
d’enfants bénéficient du fait que certains de leurs concitoyens ont des
enfants, mais ils n’en bénéficient quand
même pas autant que les parents qui, comme moi, ont des enfants en CPE. Ce
principe est d’ailleurs déjà à l’œuvre. Après tout, les places en CPE ne sont
pas gratuites. Les progressistes qui s’opposent à la tarification progressive
considèrent-ils qu’il ne devrait pas y avoir de tarif du tout ou que 7$/jour
est le montant maximal qu’il faut demander aux familles? Il se peut que quelque
chose m’échappe. »
Juste part ou solidarité
sociale ?
En effet, si on généralise cet argument, il
faudrait en dire autant pour le système de santé ou les services de protection
contre les incendies, la plupart des gens en santé finançant des systèmes
coûteux pour des personnes malades et des maisons qui brûlent accidentellement,
alors que ceux-ci n’en bénéficient pas autant, du moins actuellement. Cette
perspective va à l’encontre des principes mêmes de l’État-providence ;
tout comme la réforme de la loi sur les retraites cherche à inverser le rapport
de force entre le capital et le travail, la Commission sur la fiscalité et la
révision des programmes sociaux vise à passer au hachoir les principes
universels d’assurance et de solidarité sociale, qui peuvent recevoir plusieurs
justifications. Dans son livre Refonder
la solidarité (1995), Philippe Van Parijs distingue trois logiques
distinctes quant à leurs présupposés, leurs modalités et leurs conséquences
pratiques :
« Le premier idéal est le modèle
« bismarckien » : une logique d’assurance qui consiste pour des travailleurs à cotiser à un fonds
commun qui leur permettra de faire face à la maladie, à l’accident ou au
chômage involontaire qui viendrait les empêcher de travailler. Le deuxième est
le modèle « bévéridgien » : mécanisme de solidarité, par lequel les titulaires de revenus du travail ou du
capital cotisent pour leur garantir un niveau minimum de ressources au cas où
ils ne l’atteindraient pas par leurs propres moyens. Enfin, le troisième modèle
« painéen », à base qu’équité,
les titulaires de tout revenu cotisent à un fonds qui sert à payer
inconditionnellement à tout membre de la société un revenu uniforme, que
l’auteur propose d’appeler allocation universelle. Il ne s’agit plus alors pour
les plus chanceux de transférer une fraction de leurs ressources aux moins
chanceux, mais de donner à chacun une part égale au patrimoine commun, au lieu
de le laisser accaparer par ceux qui sont les mieux à même ou les plus avides
d’en profiter. » [3]
Pour revenir à la question des CPE qui
correspond au modèle « bévéridgien » de financement des biens publics,
il s’agit de savoir si la tarification progressive est compatible avec cette
forme institutionnelle de solidarité sociale. En fait, la confusion
fondamentale consiste à faire passer une politique familiale (tarif unique pour
les services de garde comme moyen de garantir leur accessibilité) comme un
mécanisme de redistribution, alors que le système d’imposition devrait être
grandement rénové parce qu’il est aujourd’hui largement déficient du point de
vue de l’égalité sociale et de l’efficacité. La tarification représente plutôt
un outil économique permettant de calibrer les incitatifs et désincitatifs sur
un domaine particulier de la vie sociale. Dans le cas des CPE, les femme sauront un incitatif à rester à la maison, et les couples devront réfléchir
davantage au fait d’avoir un deuxième ou un troisième enfant, chacun ayant un
« coût marginal » plus élevé à cause de la tarification progressive.
À l’inverse, des services de garde gratuits et universellement accessibles
incitent les femmes à retourner sur le marché du travail et contribuent
directement à la réduction du coût marginal de chaque enfant supplémentaire.
Comme le souligne l’économiste Jacques Généreux dans une entrevue à Médiapart
où il commente la réforme de la politique familiale française (qui repose sur
le même principe de la juste part) :
« Il faut éviter d’avoir des interventions fiscales ou
économiques qui visent 36 000 objectifs à la fois. Cela est aussi un b.a.-ba de
l’économie. Donc il ne faut pas vous servir d’un instrument à la fois pour un
objectif de justice sociale et en l’occurrence de politique familiale. Si vous
voulez maintenir l’incitation à l’enfance, il faut continuer d’envoyer ce
message que la France est un pays qui, quelque soit votre condition, et bientôt
votre sexe, ou votre revenu, fait tout pour aider les familles nombreuses.
Maintenant vous voulez de la justice, on a un système fiscal juste. »[4]
Le problème avec l’idée qu’il faudrait
« augmenter modérément (sic) les impôts des membres du 10%, du 5% et du 1%
les plus riches, et augmenter
modérément les tarifs de certains services collectifs », c’est que les
deux mesures répondent à des objectifs différents et sont amalgamés sous une
même catégorie. Cela laisse planer l’idée que l’augmentation des tarifs de
garde pour les classes moyennes et aisées serait un bon moyen de « faire
payer les riches ». Le gouvernement donne ainsi l’impression qu’il
applique une réforme équitable alors que dans les faits, il augmente toujours
plus le fardeau financier des contribuables au lieu d’aller chercher des
revenus dans les institutions financières, les grandes fortunes et les ressources
naturelles, invisibilisant ainsi les allègements fiscaux aux banques, aux industries
extractives et aux firmes multinationales.
L’analyse de Jocelyn Maclure pèche par son abstraction : elle repose sur une
perspective théorique qui étudie une mesure particulière en considérant que
l’imposition progressive et la tarification progressive ne sont pas
incompatibles a priori, tout en
négligeant les conséquences pratiques d’une telle réforme d’un point de vue
social. Cette analyse fait abstraction du système fiscal dans sa globalité et des
stratégies de manipulation d’un gouvernement qui cherche à légitimer une mesure
somme toute peu efficace et largement inéquitable. Le problème de la
tarification progressive peut certes être envisagé d’un point de vue purement
conceptuel, mais pour comprendre son fonctionnement réel, il faut toujours
situer ce phénomène dans un contexte social, économique et politique dans
lequel il aura de multiples effets. L’alternative entre un système fiscal juste
et la tarification progressive n’est donc pas un faux dilemme, mais deux manières concurrentes d’envisager le
financement des services publics, d’autant plus que le gouvernement libéral (ou
péquiste ou caquiste) n’ira jamais taxer les plus riches. La question de la
tarification des services publics comme les services de garde n’est pas un
problème isolé, mais l’illustration pratique d’une logique globale qui détruit
les conditions idéologiques et institutionnelles de la redistribution de la
richesse. L’alternative est donc : tarification progressive qui défavorise
les familles ou imposition réelle du 1% ; juste part ou solidarité sociale
?
« Alors si ce gouvernement voulait de la justice, au lieu de s’attaquer à l’aide au logement, aux allocations familiales, etc., il ferait bien de s’attaquer très sérieusement aux dizaines de milliards de niches fiscales qui ne servent à rien, qui ne servent qu’à engraisser les patrimoines financiers et mobiliers tirés des revenus du capital. Il ferait bien de re-réglementer la finance, car il ne faut pas oublier que si 100 milliards d’augmentation de notre dette publique depuis six ans sont dus à la crise financière et la crise économique qui s’en est suivie. Celles-ci sont dues au fait qu’on ne réglemente pas la finance et les produits toxiques. Alors vous voulez de l’argent, vous voulez faire des économies, bien qu’on commence par empêcher ou interdire cette spéculation. Arrêtons de payer 50 milliards d’intérêts sur la dette publique pour engraisser les banques alors que elles peuvent emprunter à 0% d’intérêt à la banque centrale. »[5]
Pour synthétiser les arguments précédents,
voici pourquoi la tarification progressive des services de garde est une très
mauvaise idée : 1) elle représente un piètre moyen de redistribuer la
richesse, et ce n’est pas son but de toute façon ; 2) les services de
garde représentent un bien public qui ne doit pas représenter un instrument de
justice fiscale, mais une finalité sociale dont le financement doit reposer sur un système fiscal
juste, ce qui est loin d’être le cas actuellement ; 3) la tarification
progressive est contreproductive en tant que politique familiale, donnant un
incitatif négatif au fait d’avoir des enfants ; 4) elle alourdit le
fardeau fiscal de la majorité sociale alors qu’une minorité continue de
profiter d’un système qui, à long terme, mène au démantèlement des mécanismes
de solidarité de l’État social.
Pour une révolution fiscale
Toute justification portant l’accessibilité
universelle (pouvant aller jusqu’à la gratuité) des services publics
(éducation, santé, transports collectif, garderies, etc.) doit reposer sur un
modèle fiscal juste et efficace. Si on n’arrive pas à remettre en question les
causes structurelles qui minent la pérennité du modèle québécois, nous
continuerons d’instaurer des demi-mesures, des réformettes ou d’autres
tarifications progressives pour compenser les conséquences d’un système
défectueux et inéquitable. Pour le discours dominant, englué dans le dogme de l’équilibre budgétaire, du déficit zéro, du courroux
des agences de notation et de l’exode du capital, il est devenu impossible de financer adéquatement les services publics par un système d'impôts progressif. En faisant abstraction pour l’instant
du mode de production capitaliste (basé sur la propriété privée et la
prédominance du marché comme mécanisme de coordination des activités
économiques et sociales), voyons comment il serait possible de refonder le système
de répartition de la richesse afin de limiter les inégalités exorbitantes de
notre époque. Nous faisons ici référence au principe républicain, somme toute
assez simple et intuitif, d’une égalité sociale robuste (et non absolue), comme condition essentielle de la
citoyenneté et de la liberté politique.
« J'ai déjà dit ce que c'est que la liberté civile: à
l'égard de l'égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de
puissance et de richesse soient absolument les mêmes; mais que, quant à la
puissance, elle soit au-dessus de toute violence, et ne s'exerce jamais qu'en
vertu du rang et des lois ; et, quant à
la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un
autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre : ce qui suppose,
du côté des grands, modération de biens et de crédit, et, du côté des petits,
modération d'avarice et de convoitise. Cette égalité, disent-ils, est une
chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais si l'abus est
inévitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le régler? C'est
précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité,
que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. »[6]
Voilà donc un argument élégant en faveur
d’une législation fiscale nécessaire pour réaliser un certain degré de justice
sociale. Il faut d’une part établir un revenu maximum afin « que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir
acheter un autre », et d’autre part définir un revenu minimum afin que nul
ne soit « assez pauvre pour être contraint de se vendre », sur le
marché du travail notamment. Étrangement, l’impressionnante littérature sur
l’allocation universelle et le modèle « painéen »
fait abstraction des immenses revenus du capital, s’attardant ainsi à réformer
le « filet social » sans tenir compte des limites à l’accumulation de
la richesse par une minorité de fortunes et de firmes multinationales. Or, les
nombreuses analyses portant sur les écarts de revenus grandissants au sein des
entreprises mettent de l’avant la question de savoir s’il existe un ratio
raisonnable à respecter, c’est-à-dire un seuil au-delà duquel les gains
d’efficacité décroissants et les inégalités galopantes ne permettraient plus de
justifier la rémunération du soi-disant mérite des grands dirigeants. Ce ratio
devrait-il être de 1:5, 1:12, 1:30, 1:100 ? Comment éviter qu’il s’agisse
d’un critère arbitraire, d’un « nombre d’or » magique qui serait la clé de
voûte de la révolution fiscale ?
Mon collègue Gabriel Monette et moi avons
eu l’idée d’articuler deux questions théoriques distinctes, deux champs
d’investigation d’éthique économique et sociale actuellement séparés, qui
devraient plutôt reposer sur un principe normatif commun. Pourquoi ne pas
mettre ensemble les arguments en faveur de l’allocation universelle et du
revenu maximum (ou d’une forte redistribution des revenus du capital) en
établissant un rapport entre les deux ? Pourquoi ne pas réunir les
réflexions de figures de proue comme Philippe Van Parijs et Thomas Piketty afin
de refonder un système fiscal qui finance un revenu garanti pour tous grâce à
un prélèvement majeur sur les grands patrimoines (institutions financières,
revenus des grandes entreprises et du 1%) ? Bien que nous n’ayons pas
encore formulé l’argumentation complète qui sera développée dans un article
scientifique qui paraîtra ultérieurement, le ratio entre le revenu minimum et
maximum devrait reposer sur le principe de
l’utilité marginale décroissante.
L’utilité marginale d’un bien ou service
est le bénéfice qu’un agent tirera de la consommation d’une quantité
supplémentaire de ce bien ou service. Toute chose étant égale par ailleurs, une
augmentation de revenu de 100$ par mois pour une personne sur l’aide sociale
aura un impact considérable sur sa qualité de vie, tandis que l’ajout d’un
million$ supplémentaire pour une personne gagnant déjà 10 millions$ par année
n’augmentera pas son bonheur pour autant. Autrement dit, l’utilité marginale
d’une certaine quantité de ressources matérielles et sociales (biens premiers
ou capabilités) croît rapidement de 0 jusqu’à un certain point au-delà duquel
elle se met à décroître progressivement. À l’inverse du système fiscal
néolibéral ou capitaliste qui favorise actuellement l’accumulation
exponentielle des revenus
(ex), un système fiscal égalitaire, républicain et social
reposerait une redistribution logarithmique de la richesse (lnx). C’est ce qu’on
appelle l’inversion des priorités sociales en faveur du peuple, et non du
capital.
Si les modalités d’un tel principe général
restent à définir pour élaborer concrètement l’architecture institutionnelle du
système fiscal québécois, nous pourrions donner l’exemple des dix paliers
d’imposition qui permettraient de réduire les impôts de 87% des contribuables
et d’augmenter les revenus de l’État d’un milliard$. Cette mesure fiscale,
proposée par la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des
services publics et Québec solidaire notamment, suggère un plancher
d’imposition à 15% pour les revenus de 12 000$ à 25 000$, et un plafond de 34%
pour les revenus supérieurs à 200 000$[7]. Or,
cette réforme propose une redistribution entre les strates les
classes populaires et les classes moyennes supérieures, et non entre la majorité sociale
et le 1%. Un système fiscal juste devrait plutôt garantir un revenu de 15 000$
pour tous les citoyens et un plafond d’imposition à 90% pour les revenus au-delà
d’un millions$ par exemple.
Évidemment, l’inapplicabilité d’une telle
« révolution fiscale » se pose directement dans le contexte québécois,
compte tenu des limites du cadre constitutionnel canadien. Si la moitié des
impôts sont prélevés par l’État fédéral et qu’il risque très probablement de ne
pas aimer l’idée d’un revenu minimum et/ou maximum, il y a fort peu de chance
que nous puissions un jour instaurer un système fiscal juste sans
l’indépendance du Québec. Qui plus est, le financement et l’allocation d’un
revenu garanti ne pourraient pas s’articuler adéquatement dans un système
administratif bicéphale où les impôts et les programmes sociaux sont partagés
inégalement entre deux paliers de gouvernement.
Si nous prenons enfin la question du revenu
maximum qui donne un important incitatif à l’exode des grandes fortunes, cette
mobilité du 1% serait facilitée dans le contexte canadien ; Guy Laliberté
ou Pierre-Karl Péladeau pourraient facilement s’installer en Ontario ou au
Nouveau-Brunswick pour éviter le fisc québécois par exemple. Bien qu’un État
souverain limiterait cette possibilité, celle-ci demeurerait toujours présente,
comme l’illustre l’exil de Gérard Depardieu en Russie pour fuir l’impôt à 75%
pour les revenus au-delà d’un millions€. Nous pouvons alors recourir à un
« patriotisme fiscal » basé sur la solidarité sociale, les très
riches devant accepter la « modération de biens et de crédit » sans
quoi ils risquent de subir l’ostracisme de la majorité populaire. La solidarité
nationale serait alors basée sur l’adhésion aux conditions de l’égalité entre
citoyens, tous devant accepter les termes d’un nouveau contrat social qui
permettrait de financer adéquatement les services publics sans devoir passer
par les tergiversations de la tarification progressive. Comme l’indique Jacques
Généreux :
« La seule vraie justice fiscale si vous voulez, la manière la
plus intelligente de l’établir, c’est d’avoir un système global fiscal qui est
juste, c’est-à-dire un impôt sur le revenu qui ne représente pas des broutilles
mais une part essentielle de l’imposition. Celui-ci doit être très progressif,
partir de 0, puis 1%, 2%, etc., jusqu’à 100% pour des revenus exorbitants dont
personne n’a besoin. Donc si vous avez un système fiscal juste, qui répartit
équitablement la charge du financement des biens communs, ensuite vous pouvez
avoir des biens publics qui soient accessibles à tous dans les mêmes conditions.
Que vous soyez fils d’industriels ou fils d’ouvrier, vous avez un droit égal à
l’école publique de la République; vous avez le droit d’être sauvé dans la rue
par les pompiers gratuitement ; vous avez droit aux mêmes prestations que les
autres ; vous avez droit à des allocations familiales parce que c’est un
supplément de coût et on veut inciter les gens à faire des enfants. »[8] Telle est la perspective d’un républicanisme véritable,
qui allie les principes du socialisme et de l’indépendance afin de garantir
l’accès universel aux biens communs.
[1] Jocelyn Maclure, Impôt progressif vs
tarification progressive: vers une démonstration plus étoffée?, A Canadian
Public Affairs Blog, 31 mai 2014.
http://induecourse.ca/impot-progressif-vs-tarification-progressive-vers-une-demonstration-plus-etoffee/
http://induecourse.ca/impot-progressif-vs-tarification-progressive-vers-une-demonstration-plus-etoffee/
[2] Ibid.
[3] Pierre-Olivier Monteil, « Clarifier les
logiques de la solidarité », Autres
Temps. Cahiers d’éthique sociale et politique, vol. 55, no. 55, 1997,
p.100-101
[6] Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, II, XI, Flammarion, Paris, 2001, p.91-92
[7] Coalition opposée à la tarification et la
privatisation des services publics, 10
milliards$ de solutions, septembre 2014.
http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/DocmentCampagne-10-milliards_WEBseptembre2014.pdf
http://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/DocmentCampagne-10-milliards_WEBseptembre2014.pdf
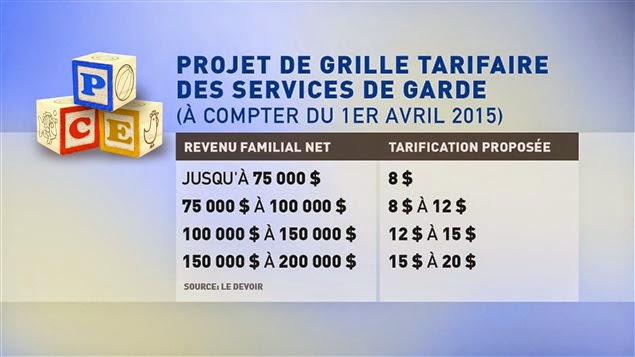




Parmi les autres considérations, c'est qu'est-ce que cette augmentation fera des choix des parents aisés. Le recours aux travailleuses domestiques est moins grand au Québec en raison des CPE accessibles. Je peux très bien imaginer de nombreux parents aisés choisir l'embauche de travailleuses domestiques résidentes, payé en dessous du salaire minimum, sans protection de la CSST et une avec statut d'immigration extrêmement contraignant. En tous cas, je n'ai pas fait toutes ces batailles pour l'égalité de certaines femmes se réalise au détriment d'autres femmes.
RépondreSupprimerAlors si je reprends la synthèse des arguments contre la tarification progressive, voici quelques idées qui permettent de continuer le débat:
RépondreSupprimer1) C'est vrai que le b.a-ba de l'économie suggère d'éviter de poursuivre plusieurs objectifs avec un même politique. Par exemple, si l'on souhaite aider certains groupes (les plus pauvres, les familles, etc.) il vaudrait mieux prévoir des allocations qui les ciblent directement plutôt que de financer des programmes universels qui pourront potentiellement les aider. Cela dit je ne crois pas que ce soit un très bon argument pour discréditer la tarification progressive comme moyen de redistribution. Après tout, l’impôt sur le revenu joue également un rôle de désincitatif au travail, tout en cherchant à financer l’État et à amoindrir les inégalités, et tu n’as pas de malaise à le défendre.
2) et 3) Les services de gardes n’on rien d’un bien public au sens strictement économique (leur consommation est à la fois rivale et exclusive). Je pense que ce que tu avais en tête est le phénomène d’externalité positive, car la société a affectivement besoin d’une relève (de préférence bien éduquée) pour se perpétuer. Cela dit, l’argument comme quoi il nous faut une politique familiale toujours plus généreuse est seulement valide à partir du moment où l’on présuppose que d’avoir des enfants est un pur don à l’humanité. Je ne crois pas que ce soit le cas, car il faut admettre qu’une part de la décision d’avoir des enfants est également égoïste (que ce soit par souci de réalisation de soi ou désir biologique de perpétuer ses gènes). C’est pour ca que M. Maclure, dans son article dans L’actualité, parle de biens hybrides, qui doivent conséquemment être financés en partie par la société et en partie par l’individu.
4) Je pense que l’argument le plus puissant est qu’effectivement, même si la tarification progressive est défendable sur le plan théorique, le projet libéral actuel n’est certainement pas motivé par un authentique désir d’établir une « égalité sociale robuste », et en ce sens elle mérite d’être dénoncée. Cela dit, j’aimerais bien te retourner l’argument de type pragmatiste au sujet de la mise en place d’impôts sur le revenu plus élevé pour les plus fortunés et les entreprises cette-fois. Dans un contexte de mobilité des capitaux accrue, phénomène que le Québec a lui seul, qu’il soit indépendant ou non, n’arrivera certainement pas à inverser, ne crois-tu pas que l’option de taxer la consommation, beaucoup plus difficilement délocalisable que les revenus, ne soit une piste d’avenir?
Gabriel S.B.